La maison urbaine à la fin du Moyen Age
Février - mai 1990
La maison dans la ville
Construction de la maison
Aspect matériel extérieur
Aspect matériel intérieur
La maison, réalité économique
La maison, dangers, risques
Survie de la maison médiévale
Glossaire
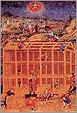 |
Si les villes ne sont pas absentes de l'iconographie médiévale, elles sont souvent représentées de façon schématique, soit qu'elles agrémentent un paysage ou servent à localiser une image, soit que l'action mise en scène ait un rapport direct avec la ville, comme une entrée royale ou un assaut guerrier. La ville en question est alors identifiée par une légende en rouge située en-dessous de la miniature ou par un emblème caractéristique : ainsi un étendard marqué S.P.Q.R. désignera la ville de Rome dans l'illustration d'un récit inspiré de l'Antiquité. Les maisons urbaines seront dans ce cas suggérées par des alignements de toitures en dents de scie dépassant à peine du haut des murailles.
Une ville peut également être représentée en tant que telle, pour autant qu'elle soit suffisamment fameuse, comme Jérusalem, Rome ou Constantinople. Mais ce sera toujours de façon symbolique, sous la forme d'une enceinte circulaire et garnie de tours, enfermant des monuments épars, isolés et figurés de façon succincte. Jérusalem sera dans ce cas identifiée par la présence du Saint-Sépulcre, Rome par le Colisée, et Constantinople par Sainte-Sophie. En revanche, dans la plupart des cas, les maisons urbaines qui entourent les monuments ne seront même plus figurées.
A la fin du Moyen Age on passe de cette figuration conventionnelle de villes toutes semblables à une description de plus en plus exacte de cités déterminées, mais réutilisées en dehors de leur contexte. Paris, souvent représentée, sert ainsi de toile de fond aux scènes les plus exotiques, se déroulant à Alexandrie ou ailleurs. Les monuments sont dès lors représentés en situation au sein de l'habitat urbain qui peut d'ailleurs les dissimuler en partie.
Dans le même temps, la ville occupe une part toujours plus importante de l'image, jusqu'à former le thème central de l'illustration. Ainsi le plan d'Orléans figurant dans l'exposition illustre-t-il une mésaventure advenue au confesseur de Talbot, lors de la levée du siège d'Orléans : alors qu'il devait convoyer un Français prisonnier dont les jambes étaient entravées, il fut laissé en arrière par les troupes anglaises. Son prisonnier le saisissant alors à la gorge lui fit faire demi-tour et le força à le porter sur son dos jusqu'à Orléans. En l'occurence, la ville est toujours le décor d'une intrigue, mais celle-ci est rejetée à la périphérie de l'image.
Enfin on aboutit à de véritables portraits de villes et à des plans de plus en plus précis. Au sein de ces images, les maisons sont de plus en plus détaillées dans leurs formes et dans leurs structures, encore que seuls les monuments les plus remarquables soient figurés avec exactitude.
Construction de la maison médiévale
 |
La construction d'une maison urbaine est événement mineur qui n'intéresse pas en tant que tel les miniaturistes. Ceux-ci ne peignent la société qui les entourent que pour illustrer des scènes tirées de la Bible, de l'histoire ou d'oeuvres romanesques, en les replaçant dans la vie de tous les jours. Toutefois, lorsque le sujet le permet, comme la construction de l'arche de Noë, on peut trouver des représentations de maçons ou de charpentiers au travail.
L'idée la plus répendue d'une ville médiévale est celle de maisons étroites et sombres, enserrant des venelles puantes et insalubres. Le tissu urbain est pourtant à l'origine relativement lâche ; les parcelles comprennent des jardins destinés à fournir une part de l'alimentation des citadins. Mais au cours des siècles, le jeu des successions divise les propriétés en parcelles toujours plus petites sur lesquelles on bâtit de plus en plus en hauteur, ce qui entraîne la construction de hautes cheminées, de préférence en pierre pour éviter les incendies. La compétition sociale amène le goût des façades en bois sculpté comme expression de l'aisance matérielle. Un souci esthétique n'est pas étranger à la bourgeoisie aisée dans les villes de l'extrême fin du Moyen Age et de la Renaissance. Dans ces conditions la construction d'une maison urbaine devient une affaire de spécialistes (charpentiers, maçons, couvreurs). Nous sommes renseignés par des contrats passés devant notaire qui indique le coût et les dimensions des bâtiments en projets, ainsi que la disposition des lieux.
 |
La maison urbaine de la fin du Moyen Age (nord du royaume, région de la Loire) est essentiellement construite en bois et en torchis. Les toits sont le plus souvent couverts de tuiles plates ou de bardeaux, parfois d'ardoises. Les variantes sont évidemment nombreuses selon les particularités locales en matière d'habitat, l'origine sociale du propriétaire et la date de construction. Une évolution des techniques est probable. Une maison du XVe siècle serait caractérisée par une façade où les poutres sont disposées en caissons enfermant des croix de Saint-André, tandis qu'au XVIIe siècle le pan de bois serait vertical, stabilisé par une ou deux poutres disposées en oblique.
La maison urbaine à la fin du Moyen Age compte habituellement plusieurs étages, généralement deux ou trois, les étages supérieurs étant moins hauts que les étages inférieurs. Elle peut être en encorbellement, ce qui permet à la fois de protéger la façade du ruissellement des eaux de pluie et d'augmenter la surface habitable des étages. La façade peut représenter des poutres apparentes peintes et sculptées. D'autres maisons sont recouvertes d'un enduit monochrome ou multicolore, parfois, mais plus rarement, décoré de fresques ou d'inscriptions.
Le rez-de-chaussée abrite souvent une boutique signalée par une enseigne qui déborde sur la rue, représentant la marchandise proposée ou en forme de rébus ; ainsi une hostellerie sera signalée par un lion doré,signifiant "au lit on dort", vantant peut-être de façon exagérée la qualité de ses installations. Une hache dorée se lira "à l'âge d'or" et signalera un cabaret.
La maison urbaine a généralement "pignon sur rue", ce qui signifie que l'arête du toit est perpendiculaire à la rue. Cette succession de façades triangulaires donne un aspect typique à l'iconographie urbaine médiévale. Sauf aux Pays-Bas cet aspect a été profondément modifié depuis le Moyen Age, la réglementation du XVIIIe siècle ayant contraint les citadins à transformer leurs toitures de façon que les murs mitoyens, surélevés, servent de pignon et fassent office de coupe-feu. Cela fut fait pour éviter qu'un incendie ne se propage facilement à travers une succession de toits parallèles.
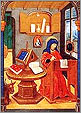 |
Dans les miniatures figurent en majorité les demeures des nobles ou des bourgeois aisés : la vie des pauvres n'intéresse que médiocrement les enlumineurs. Les seules représentations de chambres modestes que nous ayont illustrent la nativité du Christ, qu'on se plaît d'ailleurs à représenter dans des intérieurs familiers plutôt que dans une crèche entre le boeuf et l'âne. Les pièces d'études des différents Docteurs et Pères de l'Eglise sont également nombreuses. Par contre les caves et les greniers ne sont que rarement figurés, tout au plus voit-on apparaître, pour les besoins de l'histoire, des celliers construits au rez-de-chaussée. Les cuveaux servant à se baigner sont pratiquement absents des maisons ordinaires, car si on se lave souvent, on se baigne peu, se baigner trop étant souvent réputé, d'après les médecins du temps, rendre malade ; quant aux "étuves", elles ont souvent mauvaise réputation.
Les sols sont faits de parquet ou de carreaux de couleurs alternées ou décorés de motifs complexes, les tapis sont rares. Les murs sont en général nus, les tapisseries étant un luxe que peu de gens peuvent s'offrir.
Les pièces sont assez médiocrement éclairées par des fenêtres étroites, mais de plus en plus fréquement équipées de vitraux et de volets.
Les inventaires après décès nous renseignent sur le mobilier médiéval, surtout des intérieurs bourgeois et nobles. Le meuble le plus important est le lit, qui dispose de draps, de couvertures, de coussins et de rideaux pour isoler du froid. Viennent ensuite un petit nombre de coffres, de fauteuils et de bancs. Enfin les tables, qu'utilisent surtout les lettrés et les artisans, qui sont parfois de simples planches posées sur des trétaux, mais parfois déjà de véritables meubles.
Assiettes, gobelets, pichets, couteaux et cuillers, en bois, fer ou étain forment l'essentiel du nécessaire de able. La fourchette est une invention plus tardive. Si la vaisselle de bois ne nous est qu'exceptionnellement parvenue, de même que la vaisselle précieuse, souvent refondue entre-temps, la céramique est bien consevée.
Représentant un investissement somme toute considérable, l'édification d'une maison coûte cher. C'est pourquoi ceux qui fond construire tentent de diminuer leurs frais en payant charpentiers et maçons en vin et en vêtement, ou en leur fournissant une partie du matériau en construction.
La maison urbaine est par ailleurs un enjeu économique comme un autre, et peut être l'objet de toute sorte de marchés. Elle supporte des rentes et entre par là même dans le jeu du crédit. Les notaires sont les garants et les témoins de ces transactions dont ils nous ont conservé la trace. On loue ou on vend des maisons entières, des étages, des pièces, des demi-caves. Ces marchés sont assortis d'accords de circulation minutieusement stipulés pour éviter toute nuisance et toute querelle.
Un propriétaire peut également diviser ses biens entre ses héritiers, ou leur transmettre une maison en indivis, ce qui a l'avantage de paralyser pratiquement les confiscations. Au bout de quelques générations des dizaines de personnes peuvent ainsi se partager un même bâtiment, à moins que l'une d'entre elles n'ait racheté les parts des autres.
Bien construite et bien entretenue, la maison de bois est pratiquement éternelle. Elle est cependant vulnérable. Pour peu que le bois utilisé soit un peu trop vert, ou le toit un peu trop exigu, ce qui arrive en période de spéculation immobilière, les insectes et la pluie auront tôt fait de transformer la maison la plus pimpante en un tas vermoulu. En règle générale, une maison construite sans soin particulier ne dure qu'une génération.
Les villes française ayant été assez peu frappées par les tremblements de terre, l'incendie est la première et plus redoutable menace. Un feu de cheminée ou une chandelle renversée peut provoquer l'incendie d'une ville entière, le feu se communiquant de toiture en toiture, ou de façade en façade dans les rues les plus étroites. De même un assaut peut causer de redoutables dégats, car les soldats aiment à brûler les villes qu'ils ont pillées. Les faubourg non fortifiés sont particulièrement exposés aux déprédations des hommes d'armes, pour autant que les citadins ne les incendient pas eux-même préventivement, pour éviter que l'assaillant ne s'installe à son aise, ou n'utilise les maisons les plus proches du rempart pour protéger des travaux de sape.
Plus simplement et plus généralement, une maison en bon état peut être démolie pour construire à son emplacement une église, ou encore parce que, construite contre les fortifications urbaines en dépit des règlements des échevins, elle aura été rasée par décision municipale. Des phénomènes de mode architecturale ou des besoins d'agrandissement peuvent également amener une refonte ou une reconstruction de la maison.
Rares sont les maisons du Moyen Age qui aient échappé aux dangers qui les guettaient, on en compterait tout au plus trois ou quatre dans le département du Loiret. L'urbanisme postérieur leur aura souvent été fatal, de même que l'évolution des goûts en matière de logement, exigeant plus de place, de confort, de lumière. Recouvertes d'un épais badigeon, d'autres dissimulent peut-être leur âge véritable, que la facture de leurs pans de bois pourrait révéler.
L'idée de conserver ces vieilles demeures n'est qu'assez récente, pourtant, le romantisme commença déjà à être sensible à leur esthétique. C'est par hasard qu'elles ont survécu aux campagnes de reconstitution au goût du jour qui marquent les périodes successives de prospérité des villes. Les modernisations de la fin d siècle dernier, si elles n'épargnèrent pas plus que les autres les maisons médiévales, eurent au moins le mérite de nous conserver fidèlement le souvenir de bâtiments détruits, par la photographie ou le dessin d'architecte. Ces vieilles maisons à pans de bois nous apportent un témoignage émouvant sur la vie de nos ancêtres, à considérer toutefois avec prudence en raison des modifications qu'elles ont inévitablement subies, et du principe de sélection ; presque toujours se sont les maisons les plus éloignées des centres d'activité - économique ou politique - qui ont été préservées.
Elles fournissent aussi des renseignements inattendus sur le climats de l'époque à laquelle elles furent construites : l'examen de leurs poutres permet, en fonction de la largeur des anneaux de croissance, de retracer les données climatiques qui ont précédé l'abattage de l'arbre (dendrochronologie).
Arbalétriers : pièces de charpente obliques, perpendiculaires à l'axe du toit, reposant sur l'entrait et se rejoignant deux par deux au faîte pour supporter la panne faîtière.
Colombage : désigne un type de maisons à pans de bois dont l'étage en surplomb est soutenu par des poteaux verticaux élargis au sommet, appelés colombes.
Chevrons : pièces de charpente obliques, perpendiculaires à l'axe du toit, reposant sur les pannes et supportant la couverture du toit.
Encorbellement : désigne un étage en surplomb soutenu par les solives de l'étage inférieur.
Entrait : pièce de charpente horizontale, perpendiculaire à l'axe du toit, sur laquelle reposent les arbalétriers.
Mur gouttereau : mur parallèle à l'axe du toit.
Mur pignon : mur perpendiculaire à l'axe du toit, dont la partie supérieure forme un triangle.
Pans de bois : poutres de bois formant l'armature d'un mur de torchis.
Panne : pièce de charpente horizontale, parallèle à l'axe du toit. La panne faîtière qui supporte les chevrons n'est pas utile quand les arbalétriers sont nombreux et rapprochés.
Sablière : poutre horizontale, supportée par les murs gouttereaux et supportant le plancher de l'étage supérieur.
Torchis : mélange d'argile et de paille, appliqué sur un clayonnage entre les pans de bois pour constituer un mur.
©Olivier Bouzy